|
 |
|
 |
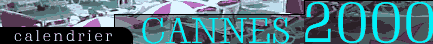 |
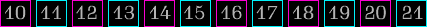 |
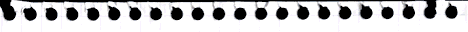 |
  |
|  MUSICANNESL'air de rien, ce n'est pas les images qu'on retient, mais bien les chansons. Façon Disney, les cinéastes sélectionnés nous font chanter.
Intermède musical style Broadway ou chorégraphies sorties de West End, la
chanson fait partie intégrante du scénario, de la narration et de
l'originalité de l'oeuvre.
Au lieu de nous raconter des salades de textes, on nous compose une salade
" cannoise " multilingue et colorée. Chaque chef a sa recette - à défaut de
cumuler les recettes en $.
Ken Loach nous a évité Guantanaméra mais son orchestre de la MJC locale
nous a gentiment cassé les oreilles avec son hymne à l'immigré exploité
(autant reprendre l'Internationale dans ce cas). C'est toujours mieux que
les gargarismes aigus et soi disant harmonieux de la Dombasle dans Vatel.
Mais Loach aurait du demander conseil à la portugaise Maria de Medeiros qui
n'a pas hésité à remixer une scène des Parapluies de Cherbourg et compiler
des chansons d'époque. C'est l'une d'entre elles - ni fado, ni brûlot - qui
lance la révolution.
Au milieu de ce concert polyphonique, il y a Liv Ullman, qui impose un
maestro (modèle pingouin pour les marches) dans son casting vedette. De
quoi nous faire réviser nos gammes entre chaque monologue monocorde. La
Victoire de la musique pour la meilleure chanson revient surtout aux frères
Coen et à leur tube entêtant, blues gras qui fait taper des pieds, claquer des mains. Et hop, on reprend en choeur...
Comme dans La Noce où Lounguine meuble sa cérémonie noyée dans la vodka de chansons paillardes, gaillardes et soûlardes. Ca danse, ça swingue à
l'accordéon et même le curé s'y met. Le meilleur morceau est sans doute
Besame Mucho (Dalida revisité !) qui à deux reprises se voit massacrer par
les fêtards.
 On passera sur Honest, lamentable réalisation d'un
chanteur-compositeur-producteur avec des chanteuses pop à la mode
(comprendre elles font les boutiques plutôt que d'apprendre à chanter). En
revanche, ne boudons pas le requiem de Darren Aronofsky, qui finit en film musical, où les images entrechoquent la symphonie morbide créée pour
l'occasion. La musique colle au montage et chaque son, celui d'une scie ou
d'un électrochoc, procure des sensations, par forcément agréables. La
musique, toute seule, est somptueuse.
On passera sur Honest, lamentable réalisation d'un
chanteur-compositeur-producteur avec des chanteuses pop à la mode
(comprendre elles font les boutiques plutôt que d'apprendre à chanter). En
revanche, ne boudons pas le requiem de Darren Aronofsky, qui finit en film musical, où les images entrechoquent la symphonie morbide créée pour
l'occasion. La musique colle au montage et chaque son, celui d'une scie ou
d'un électrochoc, procure des sensations, par forcément agréables. La
musique, toute seule, est somptueuse.
Dans Chunhyang, le sud-coréen Lim Kwon Taek nous la joue Chahine (avec des visuels à la Hou Hsiao Hsien), et nous offre un grand livre d'images,
entrecoupées de chansons et de ballets gestuels. Les poèmes récités et
chantés font les liens entre les tableaux.
| |
|
| |
 Mais c'est évidemment Dancer in the Dark qui est la symbiose et la quintessence de ce genre revenu au goût du jour depuis Evita et On connaîtla chanson. Von Trier nous écrit un drame, filme avec de la vidéo
numérique, et fait improviser Deneuve, demoiselle mais fausse jumelle. Au
milieu de cette histoire du danseur qui rêve dans le noir, dans cet opéra
tragique et sombre, l'artiste Björk n'est pas qu'une actrice. Des machines
sortent des sons. Des bruits, elle en fait des partitions. De la réalité,
elle laisse libre cours à son imagination. Pour s'évader, elle s'invente
danseuse dans une comédie musicale. Elle vit sa vie par procuration...
Dans une usine, dans un train de marchandise, dans une maison ou encore en
prison, la petite puce islandaise électronise son environnement. On est
très proche de l'atmosphère du clip de Madonna, Express Yourself, et du
metallo-techno-dance des Tambours du Bronx. Le feu et le fer comme
instruments de musiqueS On se laisse envahir par ses amères mélodies du
bonheur qui font son malheur. Rien n'est fait à Demy. Von Trier va jusqu'au
bout de ce requiem pour un monde con. Mais c'est évidemment Dancer in the Dark qui est la symbiose et la quintessence de ce genre revenu au goût du jour depuis Evita et On connaîtla chanson. Von Trier nous écrit un drame, filme avec de la vidéo
numérique, et fait improviser Deneuve, demoiselle mais fausse jumelle. Au
milieu de cette histoire du danseur qui rêve dans le noir, dans cet opéra
tragique et sombre, l'artiste Björk n'est pas qu'une actrice. Des machines
sortent des sons. Des bruits, elle en fait des partitions. De la réalité,
elle laisse libre cours à son imagination. Pour s'évader, elle s'invente
danseuse dans une comédie musicale. Elle vit sa vie par procuration...
Dans une usine, dans un train de marchandise, dans une maison ou encore en
prison, la petite puce islandaise électronise son environnement. On est
très proche de l'atmosphère du clip de Madonna, Express Yourself, et du
metallo-techno-dance des Tambours du Bronx. Le feu et le fer comme
instruments de musiqueS On se laisse envahir par ses amères mélodies du
bonheur qui font son malheur. Rien n'est fait à Demy. Von Trier va jusqu'au
bout de ce requiem pour un monde con.
Et la Croisette se laisse bercer par des enchantements dignes des sirènes
d'Ulysse (celui des Coen), où nous traversons le miroir, et courrons
acheter les BOF pas bof du tout. On fera une exception avec Saint-Saens,
qui orne le générique du festival et qui au bout de 25 projections/an (et
donc plus de 100 pour ma part), lasse un peu. Grâce à l'ouverture de Dancer
in the Dark, on y a d'ailleurs miraculeusement échappé.

| | |
|
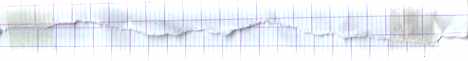 |
| 
D- Day
Quelle belle journée cannoise nous promettait ce
mercredi ! Comme chaque année, les quatre derniers
jours du Festival seront décisifs, intenses et
grouillants, puisque la manifestation vient de trouver
sa première Palme en la personne de Lars Von Trier.
Une onde de choc a envahi le Palais : comme souvent
avec le cinéaste danois, impossible de rester dans la
demi-mesure : on déteste ou on adore. Si l’on se fie
aux yeux rouges qui défilaient ce matin à la sortie de
la projection, on comprend vite de quel côté le c¤ur
des festivaliers balance╔celui de la Palme !
 Après un tel moment d’émotion, le plus difficile est
justement de garder la tête froide. Les jeux sont loin
d’être faits, et beaucoup d’autres films prometteurs
nous attendent, qu’il serait injuste de négliger avant
même de les avoir découverts. D’autant que «Dancer in
the Dark » est loin d’être un film consensuel : c’est
déjà ce qui avait coûté sa Palme à Lars Von Trier
l’année où il présenta « Breaking the Waves ».
Après un tel moment d’émotion, le plus difficile est
justement de garder la tête froide. Les jeux sont loin
d’être faits, et beaucoup d’autres films prometteurs
nous attendent, qu’il serait injuste de négliger avant
même de les avoir découverts. D’autant que «Dancer in
the Dark » est loin d’être un film consensuel : c’est
déjà ce qui avait coûté sa Palme à Lars Von Trier
l’année où il présenta « Breaking the Waves ».
Pour notre chance, Dieu créa la femme et Gilles Jacob
invita Agnès Varda à donner une leçon de cinéma au
Festival. De quoi retrouver ses esprits tout en
douceur, porté par la chaleur et l’intelligence de
cette réalisatrice indispensable, dont on ne parle
jamais assez. Pour preuve : la composition du public,
très féminin mais surtout très jeune, venu apprendre
d’une cinéaste qui a énormément à donner.
Fidèle à son bagout et sa frange, Agnès Varda a tenu à
dire qu’elle ne venait pas vraiment donner une leçon đ
«je m’en sens incapable »- mais dialoguer sur le
cinéma qu’elle connaît, celui qu’elle aime, et
répondre à une question essentielle : comment
apprendre le cinéma ? Futurs réalisateurs, cinéphiles
ou critiques, tous ont effectivement appris, suspendus
aux lèvres d’un petit bout de femme qui a en a
beaucoup dans la tête. Parce qu’elle était riche en
anecdotes, sa «leçon » fut passionnante, tour à tour
drôle et poétique.
| |
|
| |
Impossible donc d’en livrer tous les trésors, il faudra se contenter de quelques clés décisives pour
mieux comprendre son ¤uvre et son amour du cinéma.
Incroyable mais vrai, Agnès Varda n’avait vu que cinq
films quand elle a tourné pour la première fois («La
pointe courte », à 25 ans), parce qu’être un rat de
cinémathèque n’est pas tout, parce qu’elle a tiré
beaucoup de la littérature et de la peinture.
 «Regarder ce qu’il y a autour de soi », voilà
l’essentiel, y compris les tableaux des grands
maîtres. C’est en pensant à Piero de la Francesca
qu’elle choisit Silvia Monfort pour «La Pointe Courte
», c’est en regardant Vermeer qu’elle apprivoisa la
lumière, c’est avec nombre de chefs d’¤uvre picturaux
qu’elle apprit le cadrage. Un petit conseil au passage
: ne jamais oublier l’importance du hors-cadre,
l’imagination du spectateur.
«Regarder ce qu’il y a autour de soi », voilà
l’essentiel, y compris les tableaux des grands
maîtres. C’est en pensant à Piero de la Francesca
qu’elle choisit Silvia Monfort pour «La Pointe Courte
», c’est en regardant Vermeer qu’elle apprivoisa la
lumière, c’est avec nombre de chefs d’¤uvre picturaux
qu’elle apprit le cadrage. Un petit conseil au passage
: ne jamais oublier l’importance du hors-cadre,
l’imagination du spectateur.
Cette championne des jeux de mots en parla évidemment
beaucoup, lisant tour à tour une fable de La Fontaine,
un poème de Queneau ou une citation de Bunuel, «un
maître ». En voici deux, primordiaux dans la création
d’un film : motivation et inspiration, cette dernière
se situant «quelque part entre le hasard et le mystère
».
Il n’est pas si fréquent de voir un cinéaste livrer
secrets et univers intime. Mille mercis à Agnès Varda
qui nous a offert, plus qu’une leçon de cinéma, une
leçon de vie.

| | |
|
 |
|
|
 |
|
|