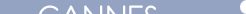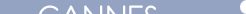|
Choix du public : 
Nombre de votes : 7
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Once Upon a Time... in Hollywood

Sélection officielle - Compétition
USA / sortie le 14.08.2019


LES IDOLES
« T’es un véritable ami. »
Il était une fois à Hollywood… Quentin Tarantino revient à un cinéma moins sombre avec cette fable nostalgique. Cette fresque en deux temps (février et août 1969, deux chapitres distincts) est dans la continuité de son œuvre, sans forcément la transcender. Il n’empêche, qu’on soit fan ou pas du cinéaste, il reste un orfèvre en scénario, dialogues et mise en scène. Généreux avec le spectateur, parfois sans doute trop gourmand, Once Upon A Time in Hollywood sait partager son plaisir pour la culture pop et satisfaire nos bas instincts avec un final jouissif.
En revenant à la fin des années 1960, le réalisateur plonge dans sa propre enfance avec une certaine mélancolie. Le film aurait presque pu s’intituler « Je me souviens ». Mais Tarantino n’est pas Perec. Sa référence, explicite, est du côté des westerns-spaghettis de Leone et Corbucci (déjà utilisé dans Django Unchained), mais aussi des séries tv de l’époque (cow boys, flics…) et d’arts martiaux (Bruce Lee va se retourner dans sa tombe). Comme à son habitude, le film s’enrichit de clins d’œil (le strip le plus hot de Brad Pitt depuis Thelma et Louise, l’achat du livre Tess d’Urberville par Sharon Tate), d’autocitations (coucou Michael Madsen et les nazis bien cramés), et d’hommages.
Ce conte épique met en effet à l’honneur sa jeunesse, sa culture de l’époque, Los Angeles (ses studios, stars et ses cinémas d’antan) et surtout la fiction de série B (ciné ou télé). Il s’offre d’ailleurs une petite réflexion sur le 7e art, en s’interrogeant sur l’image des acteurs ou des réalisateurs quand ils ne sont employés que pour certains types de rôles ou de films. Ainsi Rick Dalton (DiCaprio qui nous fait une masterclass de son talent), l’annonce : « C’est officiel. Je suis un has been ».
Fresque hybride
Ce n’est pas le cas de Tarantino. Même si on peut émettre des réticences sur ce spectacle au vernis trop parfait, il n’a rien perdu de ce qui fait l’ADN de son talent et qui le distingue dans le cinéma américain par un véritable travail d’écriture et de style cinématographique. Il sait créer des séquences cultes, des moments de bravoure pour cinéphiles avides de se régaler avec de la farce ou de l’action. Certes, on peut reprocher qu’il évacue complètement l’arrière-plan politique et que les hippies soient résumés à la secte de Charles Manson, que les nantis d’Hollywood ne soient jamais critiqués pour leur superficialité et leur désinvolture face à la réalité, mais il signe malgré tout un de ses films hybrides, entre comédie - jamais loin du pastiche, parfois un peu grossier – et drame psychologique, entre chroniques de Los Angeles et impasse de la mort.
En cela, Once Upon A Time in Hollywood est réussi, remplissant son contrat pour que le spectateur, attachés aux trois personnages principaux, acceptent un dénouement qui n’est pas celui attendu. Un final par ailleurs ultra-violent et drôle à la fois, mélange de genre risqué dont le cinéaste s’en tire avec une grande habileté, un sens de la tension et de l’inattendu, conduisant davantage à l’hilarité qu’à la frayeur, jusqu’à nous toucher avec une émotion toute douce et toute simple.
Mais avant d’arriver à cette conclusion parfaite et surprenante (quand on connaît les faits dont il s’est inspiré), Tarantino prend son temps. Il signe dans une première partie un hymne à l’industrie du rêve, des cascadeurs aux acteurs, de ces divertissements de soirée à ces films de l’après-midi. On suit ainsi un acteur qui décline, chassé du haut de l’affiche ou relégué en guests d’épisodes de série par des plus jeunes, son cascadeur – homme à tout faire, et sa voisine, la vedette Sharon Tate, la femme de Roman Polanski.
Un enfant qui joue avec ses Playmobils
Les trois offrent un point de vue différent. Tarantino persiste avec ces récits parallèles et quelques digressions (tantôt bienvenues, tantôt superflues). Ici, il prend le risque d’étirer Once Upon A Time in Hollywood, de le rendre parfois un peu bancal, un peu inégal. Mais il ne veut pas lâcher son chapitre, même s’il est trop long, pour aboutir à un court-métrage en soi. Avec DiCaprio, on est dans la reconstitution du processus de création. Tarantino recréé les tournages et les scènes d’une série des années 1960. Avec Pitt (décidément irrésistible et charismatique, malgré un personnage d’homme de l’ombre), nous nous trouvons dans la réalité et le quotidien de Hollywood. Paradoxalement, c’est la partie la plus imaginaire du film, celle où Tarantino invente toute l’histoire. Et avec Margot Robbie, sublimée, même si elle est un peu sous-utilisée, nous sommes son fan et, comme elle un spectateur, nous épousons son statut de la « femme de » tout en étant le voisin éloigné qui ne l’approche jamais. Tout le reste est secondaire ou parasitaire, hormis la chienne Brandy, Palm Dog garantie.
Cette construction narrative impose au cinéaste un temps d’installation très long de son histoire romanesque. L’alternance des chapitres perd même un peu le spectateur. Cette première partie pèse sur le film, le lestant et le ralentissant, malgré de brillants acteurs et de belles idées (Di Caprio qui tourne dans un décor de western en carton-pâte aux ennemis factices, Pitt qui se retrouve dans un décor de western habité par une secte réellement menaçante).
No Sympathy for the Devil
Pourtant, Quentin Tarantino va sauver son film, très dense, trop dense même, en lui donnant une direction différente dans sa seconde partie. Les trois récits vont confluer vers la destination finale. Et le cinéaste va réinventer l’Histoire pour se délecter avec jubilation de sa propre version, forcément fictive. Une fois de plus, en faisant cela, il fait primer le show hollywoodien sur l’atrocité des faits réels, offensant sans doute quelques mémoires. Cette immoralité est compensée par sa propre « morale » : Once Upon A Time in Hollywood se dévoile pour ce qu’il est : un portrait (bien dopé sous LSD) d’une amitié sincère et réelle (mention spéciale aux deux stars de nous y faire croire).
Sans renier son amour pour l’hémoglobine (et quelques ustensiles assez utile pour se défendre contre des êtres sataniques) et son goût pour le pillage artistique, le réalisateur, de manière assez mélancolique et avec une affection sincère pour sa ville, son métier et ses acteurs, signe là son film le plus personnel, le plus intime. Il voudrait assurément que ce monde soit meilleur, que les jolies actrices ne meurent jamais, que les loups et les requins soient renvoyés en enfer. Cependant, et avant tout, il souhaite, encore plus ardemment, garder ce lien indéfectible et affectif avec son public, solidaire dans les pires moments comme dans les meilleurs. A l’instar de cet acteur à la Eastwood période sixties qui déclare sa flamme amicale à son cascadeur protecteur. C’est un beau roman d’amitié dans le rêve californien...
vincy

 

  
|
 |
|