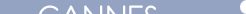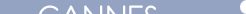|
Choix du public : 
Nombre de votes : 35
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Le poirier sauvage

Sélection officielle - Compétition
Turquie / sortie le 15.08.2018


TEL PÈRE, TEL FILS
« Sans argent, y a pas de vie. »
Le Poirier sauvage est une œuvre ample et exigeante. Pendant plus de trois heures, Nuri Bilge Ceylan déploie le récit d’un jeune homme turc relativement désespéré : par son père, qui poursuit des illusions et dilapide l’argent familial, par son pays, où la religion devient le cœur du débat politique, par son avenir, sans fiancée à l’horizon, sans métier malgré son diplôme et sans éditeur malgré son premier roman jugé très bon.
Le cinéaste palmé (Winter Sleep) poursuit ainsi son décryptage de la complexité humaine et du sens de la vie, avec une relation père fils tourmentée dans une société cupide et moralisatrice. Il est presque surprenant que Nuri Bilge Ceylan ait réalisé un film aussi peu politique alors que la Turquie bascule idéologiquement depuis quelques années, emprisonnant enseignants (comme le père) et écrivains (comme le fils), sans qu’aucune référence ne soit mentionnée dans le scénario.
Cet objet politiquement neutre ne veut pas dire que le réalisateur se désintéresse de son pays : observateur minutieux des relations humaines, il étale durant tout son film une thèse érudite et bavarde (très bavarde) où la dialectique domine tout enjeu dramatique. Des conversations peuvent ainsi durer vingt minutes autour de la littérature, l’Islam ou l’éducation. A chaque fois, le constat est assez amer, teintant le film d’une inquiétude diffuse et d’un pessimisme latent. En choisissant un homme à l’orée de son destin, par ailleurs auteur, et donc observateur des défauts et des contradictions humaines, idéaliste jugeant les actes et paroles de chacun, Ceylan dessine une sorte d’autoportrait. Il s’interroge ainsi à haute voix sur les questions qui le hantent, jusqu’à finalement affirmer que l’œuvre d’un auteur est à séparer de sa personnalité. Manière de prendre de la distance avec son film, sans qu’on n’y croie une seule seconde.
« Les gens sont bornés ici. Tous bigots. »
Dans le Nord-Ouest de la Turquie, pas loin de Troie et Gallipoli, entre ville moyenne et zone rurale, le quotidien n’est pas forcément joyeux. Mais, Ceylan insère malgré tout des séquences un peu cocasses, une forme d’autodérision, des pointes de sarcasmes et insuffle une humanité attachante à chacun de ses personnages. Il réussit même des scènes délicates et sensibles, notamment celles avec la mère. Surtout, il film majestueusement et magnifiquement ces paysages un peu montagnards, à la manière d’un Théo Angelopoulos, notamment quand il s’agit de mêler neige et brouillard, ou un ciel variable qui fait passer la campagne de l’ombre à la lumière d’un coup de nuage.
Si l’argent est au centre de l’intrigue, provoquant des divisions et des rancœurs familiales, ce n’est pas le sujet. Toujours influencé par les grands auteurs russes (Le joueur de Dostoïevski, l’œuvre de Tolstoï), Nuri Bilge Ceylan s’empare de ce grand récit sur ce qui sépare et ce qui réunit un père rêveur à son fils misanthrope, pour nous épater avec une mise en scène souvent époustouflante. Rares sont les réalisateurs capables d’imaginer et de rythmer de longues séquences d’échanges verbaux (philosophiques ou existentialistes, parfois passionnants ou au contraire saoulants) dans un huis-clos ou le temps d’un trajet à pied. Rien n’est vraiment banal : le réel s’enrichit de multiples détails et de cas de conscience.
« T'es exemplaire toi ? »
Cette maestria n’empêche pas le film d’être parfois ennuyeux, lassant et même vaniteux. Un puits sans fond… Cette arrogance cinématographique, demandant au spectateur un effort de concentration certain, peut séduire autant qu’agacer. Cette longue dissertation sur la vie et la création, sur le libre arbitre et la soumission, ne mène à aucune synthèse. On comprend bien que le réalisateur cherche la clé du bonheur (la déresponsabilisation en serait une). Mais Le poirier sauvage s’enracine dans une autre forme de dramatisation, beaucoup plus classique : ce père un peu décalé et ce fils un peu dépassé ne semblent plus s’entendre. Se réconcilieront-ils ?
En jouant avec l’image du père mort ou du fils suicidé, deux fins possibles, en tirant ainsi sur la corde (celle qui tient le berceau, celle du pendu, celle pour tirer le canapé), Nuri Bilge Ceylan s’offre une sortie de secours à ces longs plaidoyers successifs pour nous ramener à une relation humaine plus universelle et plus mélodramatique. Sans être original, l’épilogue ne cherche pas la surenchère mais démontre que de nos choix découlent notre capacité à poursuivre nos illusions et à se désintéresser du regard des autres. Bref, à assumer ce que d’autres pourraient prendre pour de la folie. Ils sont solitaires, difformes, décalés, comme un poirier sauvage.
Car, en révolte contre les absurdités de la vie, les deux hommes doivent absolument se pardonner pour faire front face aux profiteurs et aux bonimenteurs. Après tout « c’est normal d’être traité de fous par ceux qui te ne comprennent pas. »
vincy

 

  
|
 |
|