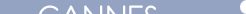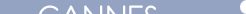|
Choix du public : 
Nombre de votes : 47
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Faute d'amour (nelyubov - loveless)

Sélection officielle - Compétition


LE NON-RETOUR
"Tu as gâché ma vie."
Andreï Zviaguintsev n’est pas franchement réputé pour porter un regard complaisant sur la Russie, et ce n’est pas avec Faute d’amour qu’il va se faire des amis au Kremlin. Son nouveau portrait au vitriol de la société russe flingue tout azimut : la corruption, la bureaucratie étouffante, le désengagement des institutions, l’individualisme exacerbé, la superficialité d’une société qui court à sa perte… Il ne manque pas grand chose à cette vision quasi apocalyptique (même la guerre en Ukraine s’invite via la télévision) qui commence symboliquement en 2012, à quelques encablures de la fin du monde annoncée par les Mayas. Sans doute est-ce d’ailleurs là les limites du film, qui veut dire trop, et le fait parfois artificiellement, voire maladroitement,. Il y a ainsi quelques ratés, mais surtout quelques facilités dans le scénario, notamment le recours un peu tarte à la crème aux médias (radio, télé) pour contextualiser son récit, et ajouter des pièces supplémentaires à un édifice déjà chargé.
Au milieu de ce tableau peu reluisant, le cinéaste met en scène des adultes égoïstes et malheureux (purs produits de leur histoire) et des enfants non souhaités, et donc non aimés, pris au piège de l’éternelle reproduction des schémas familiaux. Au coeur de l’intrigue, un couple qui se délite, et dont on comprend assez vite qu’il ne s’est jamais réellement aimé. Certains se quittent par lassitude, ces deux-là ont fini par se détester, se reprochant mutuellement une vie gâchée. Leurs disputes, terribles, jalonnent le film, et le transforment en tragédie en trois actes qui alterne leur quête intime avec une enquête au sens plus littéral du terme : alors qu'ils se déchirent, leur fils disparaît mystérieusement, et des recherches se mettent en place. Voilà pour la dramaturgie, puissante et dense.
La première dispute est fondatrice de l’intrigue : l’homme et la femme parlent dans le salon, s’invectivant sur ce qu’ils vont faire de leur fils de 12 ans, Aliocha, après leur divorce. La mère est décidée à l’envoyer en pension pour se débarrasser de lui, le père hésite. Non pas qu’il veuille absolument s’occuper de l’enfant, mais parce qu’il a peur d’être mal vu par son patron. Ambiance. C’est là que l’on assiste au plus beau plan de cinéma que l’on ait vu depuis longtemps, dans un film qui n’est pourtant pas avare en cadres étudiés et en compositions travaillées. La mère est à la salle de bains, comme en parenthèse à la dispute, et lorsqu’elle sort, refermant la porte derrière elle, la caméra découvre, dissimulé et en larmes, le jeune garçon qui a tout entendu des propos de ses parents. Les longs sanglots muets qui l’agitent retourneraient le coeur de n’importe quel spectateur.
Une autre dispute éclatera un peu plus tard, après la disparition inexpliquée de l’enfant. Dans une voiture qui oblige les parents à cohabiter, et transforme l’affrontement en huis clos oppressant. La musique trop forte, l’air qui entre violemment par les fenêtres ouvertes, les cris de la jeune femme, tout souligne l’absence de communication possible entre eux, mais surtout entre les êtres de manière générale. Comme une allégorie d’un pays où il n’est plus possible de se parler ni de s’entendre, et où il est aussi difficile d’être ensemble que de se séparer. Lorsque la troisième dispute éclatera, plus violente encore, à la fin du film, elle cristallisera toutes les frustrations et regrets des personnages, laissant éclater leurs souffrances respectives. Tout est consommé entre eux, qui sont arrivés au bout de leur parcours personnel. C’est aussi la fin de l’enquête, et finalement la fin véritable de leur histoire.
Cette incursion d’Andreï Zviaguintsev dans le domaine du film policier, qui flirte par moments avec le thriller, marque un tournant dans sa filmographie. Il joue ici avec précision des codes du genre, même s’il le fait à sa manière, avec une rigueur esthétique qui s’interdit tout effet spectaculaire. Certains plans sont si beaux (dans la forêt, dans le vieux bâtiment désaffecté) que cela donne au film un aspect presque surnaturel, une noirceur quasi romantique, renforcée par la musique délicate et minimaliste d’Evgeny Galperin. Les séquences de battue en pleine nature sont ainsi à la fois sublimées par la mise en scène, et rendues inquiétantes par l'allure martiale, presque para-militaire, de l'association qui les dirige.
Intelligemment, le cinéaste préserve l’énigme jusqu’au bout et ne donne aucune clef d’interprétation explicite. Même ses personnages gardent leur complexité, jamais réduits à des stéréotypes de « gentils » ou de « méchants », mais dépeints comme des êtres trop humains, à la fois coupables de négligence et d’indifférence, et victimes eux-aussi d’un profond manque d’affection et de tendresse. Le constat, comme toujours chez Zviaguintsev, est sombre, voire désespéré. À travers les enjeux intimes de Faute d'amour, ce sont les travers de toute une société qu'il ausculte. Le malheur ne peut entraîner que le malheur, la méchanceté ne peut que générer la méchanceté. Par extension, lorsqu’un pays néglige ses forces vives et sacrifie sa jeunesse, c’est son avenir qu’il hypothèque. Et à la vue de l'épilogue du film, glaçant, on se dit qu'il y a encore de quoi s'inquiéter pour celui de la Russie pendant un moment.
MpM

 

  
|
 |
|