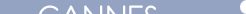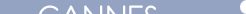|
Choix du public : 
Nombre de votes : 44
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Paterson

Sélection officielle - Compétition
USA / sortie le 21.12.2016


POÉSIE INFINIE
«- Géant ! Un conducteur de vus qui aime Emily Dickinson… »
Il faut voir Paterson comme un poème, et pas seulement parce qu’il s’agit de poésie tout au long du film. C’est une blues sentimental, une ballade nostalgique, où la répétition des jours qui passent – une semaine – et la routine sont le moteur du récit. C’est audacieux de la part de Jim Jarmusch car ce mécanisme narratif peut ennuyer très rapidement. Il est sans doute un peu difficile d’entrer dans ce film tant les premiers « jours » se ressemblent.
Pourtant, il y a toujours une variante. Paterson (Adam Driver, qui joue en finesse un rôle où toute sa vie semble se vivre à l’intérieur de lui-même) se réveille à chaque fois un peu plus tard. Il y a des événements qui modifient le cour tranquille et régulier de ses journées, constamment les mêmes : réveil, écriture, job, écriture, diner, promenade du chien, bière au bar, … Un jour sans fin.
Cela rend presque ce quotidien oppressant. Cet emprisonnement est renforcé par sa soumission à son épouse, à qui il laisse tout faire dans ses moindres délires « créatifs », son chien (qui n’en fait qu’à sa sale gueule), sa ville (qu’il n’a jamais quitté). A sa place, on étoufferait, mais lui se dit heureux. On comprend bien qu’il n’exprime jamais ce qu’il ressent, que son mal être est profond, qu’il n’a rien à voir avec tout ça. Mais il ne s’en plaint jamais malgré cette tristesse détectable.
Film à clef, Paterson, distille les signes qui vont transformer des paroles banales en coïncidences troublantes. C’est aussi une mise en abime du mot Paterson : le nom du personnage principal, le nom de la ville (qui a inspiré Allan Grinsberg, vu naître Lou Costello Et Hurricane Carter), le nom d’un poème de William Carlos Williams… Autour de ces trois axes – un conducteur de bus, des habitants anonymes et une obsession de la poésie – le cinéaste tisse une toile où chacun est relié à l’autre sans forcément le savoir. Les rêves de Laura (et là c’est un hommage à Pétrarque, pas à Preminger) trouvent des résonances dans la vie de son époux. Jarmusch s’attache autant aux poèmes de celui-ci (un peu trop d’ailleurs, tant ils ne sont pas passionnants), qu’aux conversations entre ses passages ou aux hommages à un passé révolu par le tenancier du bar. Ode à la parole et aux mots (chose qu’un chien ne peut pas comprendre), à une époque où un chute d’eau inspirait les auteurs et les smartphones n’existaient pas, le réalisateur explore l’urbanité et l’humanité dans un monde qui paraît immuable, déconnecté de la civilisation moderne (billard, échecs, juke box). C’en est presque romantique.
C’est en fait un film systémique, c’est à dire qu’il n'y a d'intelligence possible du monde si on ne saisit pas les relations que tissent entre elles les différentes parties des ensembles organisés (jusque dans ce nom Paterson: Pater/son. Père-fils. Ville/personnage.). Là tout est très bien organisé, trop bien même. Heureusement, il y a quelques grains de sable, et notamment le chien, véritable matrice de problèmes et cabot comique s’il en est. Car Paterson ne manque pas d’humour dans cette histoire où chacun se bat contre soi-même. Cette chronique va même jusqu’à s’amuser dans des délires (noir et blanc) et des situations cocasses ou des running gags.
Loin d’être formaté, le film est un peu trop réfléchi de manière cartésienne mais il ne manque pas de style et de grâce. Comme un poème il cherche la rime juste, celle qui donne une musique similaire à des mots différents. L’inconsolable perte des poèmes est aussi la possibilité d’en écrire d’autres. En cela le final résume tout le film : Paterson a bien plus en commun avec un japonais d’Osaka qu’avec tous ceux qui l’entourent. Les poètes sont connectés, se comprennent. Et s’épaulent. C’est sans aucun doute la meilleure scène du film, équilibrant humour et respect, tendresse et désespoir, fascination et complicité.
Avec ce Japonais sorti de nulle part, Paterson s’évadera de son monde suffocant (avec un chien psychopathe, une femme un peu folle, un chef qui a la loose, …) en remplissant des pages blanches à ces moments perdus. « Parfois, une page vide présente plus de possibilités… » Poésie sans fin, comme dirait Jodorowsky.
vincy

 

  
|
 |
|