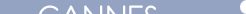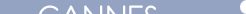|
Choix du public : 
Nombre de votes : 23
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Un conte de noël

Sélection officielle - Compétition
France / sortie le 21.05.2008


REGLEMENT DE CONTE
"- Tu ne m’aimes toujours pas ?
- Je ne t’ai jamais aimée.
- Moi non plus."
Quand Arnaud Desplechin réunit une famille pour les fêtes de Noël, il y a forcément quelques cadavres dans le placard et des poignards cachés dans les manches. Dès le départ, une petite animation rigolote nous emmène dans les méandres de la généalogie Vuillard, lourde en passif. Une mère qui n’aime pas son fils, un enfant mort que personne n’arrive à oublier, une sœur qui bannit son frère… Plutôt que dans la Petite maison dans la prairie, on est chez Shakespeare (qui clôt d’ailleurs le film), ou tout au moins dans la plus pure tragédie antique. D’autant que vient se greffer au passé un présent tout aussi tumultueux, bourré d’intrigues secondaires. Chez Junon (Catherine Deneuve) et Abel (Jean-Paul Roussillon), la vie n’en finit en effet plus de foisonner, qu’elle produise des monstres ou des héros. Mythologie, littérature, religion… fidèle à son habitude, le réalisateur truffe son récit de références (jusque dans les prénoms des personnages ou les cadeaux qu’ils reçoivent à Noël, en l’occurrence des poèmes d’Emerson) et livre un film extrêmement écrit et codifié qui assume avec panache son aspect bavard et intellectuel.
Pour le spectateur comme pour le critique, l’analyse est rude : il y a de quoi écrire un roman si l’on souhaite décortiquer Conte de Noël comme Desplechin dissèque l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus noir, de plus pathétique et donc de plus humain. Certains, probablement (et il est difficile de les blâmer), se perdront dans ce dédale de phrases, de ressentiments, de micro-actions et de personnages (ne croise-t-on pas à nouveau un Paul Dédalus, homonyme du héros de Comment je me suis disputé ?). Le cinéaste, d’ailleurs, revendique ce "désordre", cette juxtaposition "étrange" de scènes, ce fourre-tout "sans queue ni tête". A raison : le film est trop long, et nous perd à plusieurs reprises au cours de la dernière heure. Malgré cela, il nous entraîne et nous charme, ne serait-ce que par son immense intelligence et son ironie décomplexée. Et puis il y a les thèmes (pour certains chers au cinéaste) qui structurent son nouvel opus.
DE THEME EN THEME
L’idée que les morts continuent d’avoir leur vie propre au milieu des vivants, par exemple, au travers de ce frère disparu qui pèse comme un poids trop lourd sur chacun des personnages. Henri parce qu’il n’a pas été capable de le sauver, Elisabeth parce qu’elle se croit obligée d’endosser son rôle d’aîné, Junon parce qu’elle a engendré un enfant malade qu’elle n’a pas assez connu pour vraiment s'en souvenir.
Egalement l’importance métaphorique du sang (malade chez certains, compatible ou non entre d’autres) qui évoque bien sûr la filiation et son cortège de tourments. La famille comme une maladie ? Plutôt comme un lieu d’expérimentation où observer les effets du drame et du désordre. Le noyau familial, chez Desplechin, est un microcosme sans concessions et sans tabous, où l’on s’envoie à la tête les pires horreurs, et où l’on ne feint pas (ni l’amour maternel, ni les remords). Malades ensemble, malades les uns des autres, mais aussi malades les uns sans les autres, comme cette sœur qui ne veut plus jamais voir son frère, et se sent ensuite étrangement en deuil, sans comprendre de qui.
On peut aussi voir le film sous le prisme du jeu, impression d’ailleurs renforcée par la citation shakespearienne sur laquelle il s’achève. On joue sa vie à pile ou face, on calcule interminablement ses pourcentages de survie, comme un joueur de poker qui joue sa main en fonction des statistiques, on écrit et interprète des pièces de théâtre, on monologue, on regarde la caméra... Comme sur la scène d’un théâtre, les personnages vont et viennent, gesticulent, articulent leurs tirades et jettent un coup d’œil à la salle pour juger de leur effet. Faunia (encore un nom symbolique !), la seule étrangère à la famille Vuillard, rit sans cesse, même dans les moments dramatiques, parce qu’elle est comme la seule spectatrice d’une pièce jouée à huis clos. Les bagarres, les répliques cinglantes, les cris, tout l’amuse, puisque c’est seulement un jeu !
Et ainsi de suite avec l’obsession de Desplechin pour le médical et les hôpitaux, les chutes, au sens propre comme figuré, dont les personnages essaient désespérément de se relever, la tendance des femmes à "dévorer" les hommes… Soit un mélange de sujets contemporains et atemporels, disant aussi bien le mal de vivre que le bonheur d’exister. Car que l’on ne s’y trompe pas, Desplechin sait aussi filmer la douceur, l’apaisement, la complicité. Lors de l’une des plus jolies scènes de Conte de Noël, Henri et sa mère Junon s’assoient sur une balançoire et fument une cigarette. Ils sont légers, détendus, et s’avouent avec simplicité leur non amour l’un pour l’autre. On sent, à ce moment-là, la relation ambigüe et intime qui lie ces deux êtres. Comme une clef pour saisir tout le reste et ne pas rester à la surface de ce rejet apparent, trop facile et trop mélodramatique. Comme quoi sous leurs dehors brusques et mal dégrossis, les membres de la famille Vuillard sont aussi capables d’une vraie élégance. A leur niveau, chacun à leur tour, ils ont tous une touche d’héroïsme qui, paradoxalement, achève de les rendre touchants, et donc humains.
MpM

 

  
|
 |
|