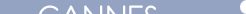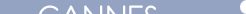|
Choix du public : 
Nombre de votes : 46
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Shortbus

Sélection officielle - Séances spéciales
USA


LA MONSTRUEUSE (LOVE) PARADE
«- C’est comme dans les années 50 mais sans l’espoir.»
John Cameron Mitchell est passé à deux doigts du film controversé culte et voué aux gémonies autant qu’à une certaine forme de génie. Deux doigts pour que l’orgasme (ou l’extase) soient sinon à son comble au moins bien senti.
On peut toujours arguer que c’est dans la tête. Blasés par tout ces sexes, ce kama-sutra de la tragi-comédie humaine, ou trop cérébraux pour apprécier cette débauche organique (et plastique). Sex Life in New York. On y parle, on en parle, autant qu’on le fait (ça fait démentir le proverbe). Une Big Apple comme vous l’avez jamais vue, par le trou de la srerrure. Fabuleuse et routinière, colorée et phallique, porno et festive. Electrique. On s’y pénètre dans tous les sens, mais peu pénètre la véritable intimité des personnages. Voire l’auto-fellation (par ailleurs auto-filmée) ne fait pas de vous le meilleur ami de l’homme (en question). Il en faut bien plus pour connaître quelqu’un.
Cette galerie de personnages fantasques et normaux n’a rien d’exceptionnel. Avouons cependant qu’ils sont touchants, attachants. Lubriques ces «Freaks» modernes. Pasolini mixé à Cassavetes, John Waters « shaké » à Woody Allen. Cette œuvre pas comme les autres (de par son processus créatif comme son sujet et ses images crues) peut plaire comme choquer.
Disons que le film est excitant. Mordant aussi par l’esprit général et des répliques hilarantes («ça bouffe des bites et ça se dit végétarien !»). Sin City où la parole, l’échange, le partage d’expérience prime sur l’émotion et le sexe.
Thérapie cinématographique, Shortbus est un peu court en sensations, en sentiments. Manque d’inspiration parfois, aussi, quand les scènes ont cette impression de déjà vu. L’exigence n’est pas présomptueuse tant l’on sait Mitchell capable de plus fou. Mais selon l’adage snob qu’il évoque « plus les films sont chiants, plus les gens se sentent intelligents », il a préféré verser dans la fable avec références techniques (les coupures d’électricité en allégorie de l’éclair de lucidité). La mécanique géométrique des corps qui s’entrechoquent dans un plan à trois devient une forme d’œuvre robotique sans plaisir, où les mots sont « rotation », et la subversion consiste à chanter l’hymne américain en bouffant un cul.
Alors on peut s’attarder sur ces giclées de sperme au mur que n’auraient pas renié Jackson Pollock, mais constatons surtout que la chair est triste et les troubles de l’identité flagrants. Cette quête permanente du bonheur factice, de la jouissance automatique, de l’individualisme déshumanisé conduit à la recherche du soi perdu.
Derrière les couleurs et la fantaisie, la génération des trentenaires déprime et se regarde. Narcissisme destructeur. La thérapie n’étant pas assez approfondie, pas assez fantastique, il nous semble évident que Mitchell n’est pas allé jusqu’au bout de son sujet. Forcément, on se retire. Avec dignité.
v. à jeun

 

  
|
 |
|